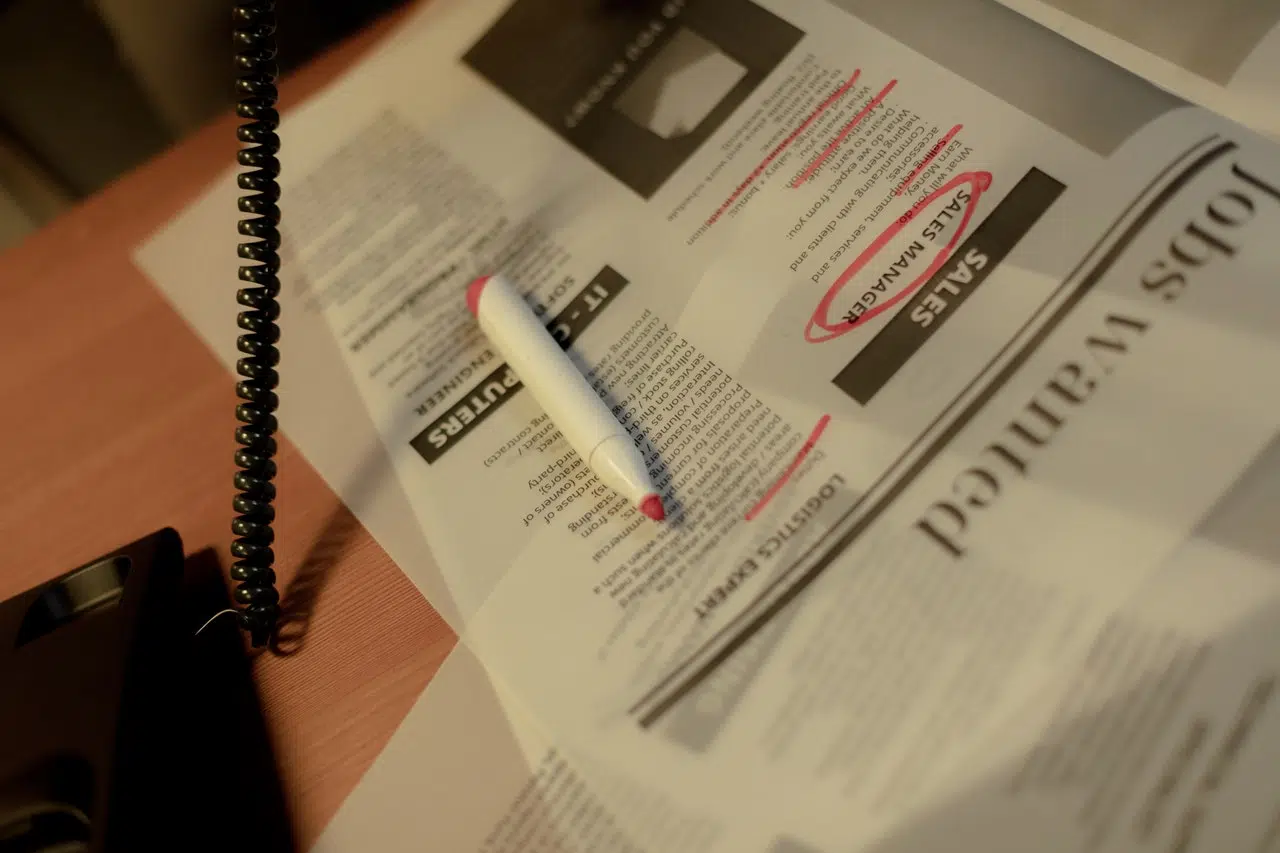Un dispositif qui suspend la paie d’un agent public malade dès le premier jour d’arrêt, sans filet de rattrapage ni compensation : voilà la règle, en vigueur depuis 2018, qui change la donne pour des milliers d’agents chaque année. Contrairement à leurs homologues du privé, ils n’ont droit à aucune indemnisation, ni de leur employeur, ni de la Sécurité sociale pour cette journée-là. Mais ce mécanisme, strict, connaît plusieurs exceptions : accident de service, maladie professionnelle, certaines affections de longue durée… autant de situations qui échappent à ce couperet salarial.
Cette gestion particulière suscite de nombreuses incompréhensions, surtout chez les contractuels à durée limitée ou les agents à temps partiel. Les règles divergent souvent en fonction du statut, du type d’arrêt, ou même de la branche de la fonction publique concernée.
Le jour de carence dans la fonction publique, de quoi s’agit-il vraiment ?
Le jour de carence désigne cette première journée d’absence pour maladie où l’agent public n’est pas rémunéré. Qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, qu’il travaille dans la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale, la règle s’applique sans distinction. Instaurée en 2012, supprimée en 2014, puis réintroduite en 2018, elle continue de s’imposer, le projet de loi de finances 2025 prévoyant même de la pérenniser à un jour.
L’objectif affiché : rapprocher la fonction publique du secteur privé, où un délai de carence existe également. Mais la comparaison s’arrête là. Un agent public voit sa rémunération suspendue dès le premier jour d’arrêt, sans indemnité versée par la Sécurité sociale. Le calcul de la retenue s’appuie sur la règle du trentième, adaptée au temps de travail effectif. En clair, c’est tout le traitement indiciaire et la plupart des primes qui sautent ce jour-là, seuls certains compléments familiaux étant maintenus.
Ce dispositif ne s’applique toutefois pas à tous les arrêts maladie. Parmi les cas exclus : le congé pour accident de service, la maladie professionnelle, les arrêts pour longue maladie ou liés à la maternité. La liste, détaillée par le ministère, comprend aussi les arrêts pour affection de longue durée ou certains événements familiaux dramatiques.
La version 2025 du projet de loi de finances va plus loin : elle prévoit de ramener l’indemnisation de l’arrêt maladie de 100 % à 90 % pendant les trois premiers mois, tout en conservant le principe du jour de carence. Le message est clair : encourager la présence tout en maîtrisant les dépenses publiques, dans une période où chaque euro compte.
Qui est concerné et comment ça fonctionne, concrètement ?
Le jour de carence touche l’ensemble des agents publics en congé de maladie ordinaire, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels. Dès réception de l’avis médical, la retenue s’applique automatiquement dès le premier jour d’arrêt. Ce principe vaut dans la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale, sans distinction.
Des exceptions, toutefois, encadrent cette règle. Voici les cas où le délai de carence ne s’applique pas :
- Accident de service ou maladie professionnelle,
- Affection de longue durée (ALD) : si le congé intervient dans les trois ans suivant un premier arrêt pour la même pathologie,
- Prolongation d’arrêt maladie pour la même affection, à condition que l’interruption entre deux arrêts n’excède pas 48 heures,
- Congé de longue maladie ou de longue durée,
- Arrêt pour grossesse ou maternité, y compris en cas de fausse couche avant la 22e semaine ou d’interruption médicale de grossesse,
- Premier congé maladie dans les treize semaines suivant le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans.
Chez les contractuels, le maintien de la rémunération dépend de l’ancienneté. Les indemnités journalières de la Sécurité sociale prennent ensuite le relais, une fois le délai de carence écoulé, avec les mêmes exceptions que pour les fonctionnaires. La protection sociale dans la fonction publique tente ainsi de trouver un équilibre, entre incitation à limiter les absences et prise en compte des situations de vulnérabilité.
Concrètement, ce que le jour de carence change pour les agents
Le jour de carence bouleverse la gestion de l’absence pour maladie. Lorsqu’un agent dépose un congé de maladie ordinaire, la rémunération saute pour cette première journée. Pas de traitement indiciaire, ni de primes ou d’indemnités, ni d’indemnité de résidence ou de nouvelle bonification indiciaire (NBI) ce jour-là. Seul le supplément familial de traitement (SFT) peut subsister si le droit reste ouvert.
La circulaire du 15 février 2018 a rétabli une coupure nette : le traitement reprend dès le deuxième jour d’arrêt, avec un calcul au trentième, ajusté au temps de travail. Cette règle conduit certains agents à se questionner : faut-il vraiment poser un arrêt pour une courte absence ? D’autres, au contraire, vivent ce dispositif comme une double peine, surtout lorsqu’un problème de santé s’impose sans prévenir.
L’impact dépasse le simple salaire de base. Pour ceux dont la rémunération dépend beaucoup des primes, la retenue sur la fiche de paie peut être notable. Face à un pouvoir d’achat déjà fragilisé par le gel du point d’indice, la multiplication des absences sur l’année finit par peser sérieusement sur le budget des agents.
Fonction publique, secteur privé : quelles différences dans la gestion de la carence ?
Dans le secteur privé, la période de carence se vit différemment. Trois jours sans indemnité ouvrent l’arrêt maladie, puis la Sécurité sociale intervient pour verser les indemnités journalières, à condition que le salarié remplisse les critères nécessaires. Plusieurs conventions collectives prévoient cependant des systèmes de maintien de salaire, parfois complétés par des assurances.
Côté fonction publique, le jour de carence ne concerne que la première journée d’arrêt pour maladie ordinaire. Dès le lendemain, l’agent retrouve son traitement indiciaire et ses droits, selon les règles statutaires. Pour les contractuels, la logique s’apparente à celle du privé : la Sécurité sociale prend le relais, avec trois jours de carence, sauf exceptions prévues.
La question de la protection sociale complémentaire trace aussi une frontière nette. Les agents publics bénéficient progressivement d’une complémentaire santé obligatoire, mais les garanties varient d’un employeur public à l’autre. Dans le privé, la généralisation de la complémentaire santé depuis 2016 a uniformisé la couverture, même si des différences subsistent selon les accords d’entreprise.
Dernière distinction majeure : le point d’indice, gelé à plusieurs reprises, pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des fonctionnaires, tandis que dans le privé, la rémunération relève d’accords collectifs ou individuels. La suppression de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) accentue cette singularité, alors que l’avenir du jour de carence demeure au cœur des débats du projet de loi de finances 2025.
La question, désormais, n’est plus simplement technique : elle touche à la reconnaissance, à la confiance et au sens même du service public. Pour les agents, chaque arrêt se mesure aussi à l’aune de cette journée suspendue, qui, loin d’être anodine, façonne le rapport au travail et à la santé dans la fonction publique.